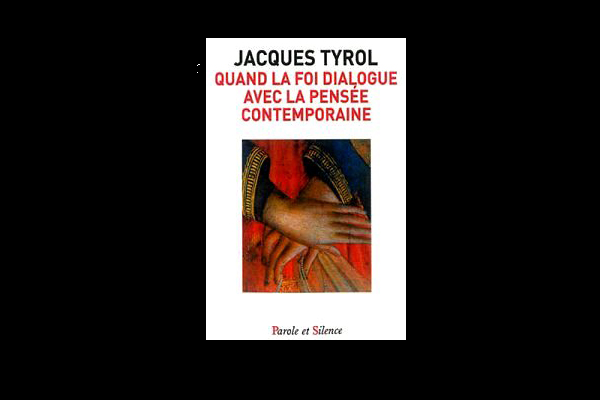Rapport entre mission et identité
Dans la dynamique de réflexion à laquelle vous m’invitez, le choix est clair : il s’agit non pas de parler de l’ « identité des laïcs » dans l’Ordre – sujet presque inépuisable depuis de longues années – mais bien de leur mission. C’est d’ailleurs comme une manière de définir l’identité, puisque l’Ordre fut « dès l’origine spécifiquement institué pour la prédication et le salut des âmes » (Prologue des Constitutions primitives). Parler de la mission des laïcs de l’Ordre, c’est donc parler de la mission de l’Ordre tout entier, les frères, les moniales, les laïcs, les sœurs, les instituts séculiers, les fraternités sacerdotales.
On peut d’emblée remarquer que ce rapport entre la mission de l’Ordre et son identité est analogue à celui que, dans sa première encyclique Ecclesiam suam, Paul VI établissait à propos de « l’Eglise qui, écrivait-il, se fait en se faisant conversation et dialogue ».
C’est dans cette perspective que je me propose de réfléchir à la mission de l’Ordre, après avoir rappelé la manière dont la Constitution fondamentale la définit pour les frères :
« En notre qualité de coopérateurs de l’Ordre des évêques, de par l’ordination sacerdotale, nous avons pour office propre la charge prophétique dont la mission est d’annoncer partout l’Evangile de Jésus-Christ par la parole et par l’exemple, en tenant compte de la situation des hommes, des temps et des lieux, et dont le but est de faire naître la foi, ou de lui permettre de pénétrer plus profondément la vie des hommes en vue de l’édification du Corps du Christ, que les sacrements de la foi amènent à sa perfection ».
LCO 1, § V
Je me propose, à partir de cette définition, de tenter de formuler l’inspiration de la mission de l’Ordre, puis d’envisager cette mission en explicitant, à partir de textes de notre Ordre, sa dynamique plutôt que son « contenu », pour enfin retenir quelques urgences, pour ce que je nommerai la mission de la fraternité.
Une « inspiration »
Le dialogue comme un défi
Quels sont les points communs entre ces deux évocations, de la Constitution fondamentale et de l’encyclique ?
La perspective de la mission désigne le dialogue comme un défi, non pas un objectif à mener à bien comme on doit mener, interminablement, un dialogue multilatéral pour se mettre d’accord sur la manière dont on pourrait envisager un accord sur le désarmement, mais comme intrinsèquement lié au devenir essentiel de l’Eglise et de l’Ordre.
Pour l’Eglise, devenir c’est devenir ce qu’elle est, à savoir dialogue.
Pour l’Ordre, c’est devenir voué à l’Eglise « d’une façon nouvelle » qui nous députe « totalement à l’évangélisation de la parole de Dieu en son intégrité » (LCO &, § III) : la mission de l’Ordre comme une tâche d’évangélisation de la Parole de Dieu.
Il ne s’agit donc pas seulement de « proclamer » la Parole de Dieu, ni de prétendre posséder la Parole de Dieu et de la transmettre. Il s’agit plutôt, dans le dialogue avec nos contemporains, de faire en sorte que, la Parole de Dieu, et non pas notre discours, soit entendue dans le monde comme une bonne nouvelle pour le temps d’aujourd’hui.
D’une certaine manière, telle est l’hypothèse que je voudrais démontrer : la mission de l’Ordre est d’être voué à servir dans et pour l’Eglise le dialogue apostolique, à cause de l’Eglise et à cause de Celui dont l’Eglise est le corps, et ce pour « évangéliser la Parole de Dieu », c’est-à-dire manifester la Parole de Dieu comme bonne nouvelle pour l’humanité.
Si telle est la mission de l’Ordre, c’est donc bien la mission des laïcs de l’Ordre, comme pour tous les autres membres de cet Ordre. Et si je dis ici « mission », c’est pour bien souligner qu’à partir du moment où un frère, une sœur, un laïc, demande à l’Ordre la miséricorde de l’accueillir et de l’incorporer, c’est pour que l’Ordre accueille cette générosité pour l’Evangile qu’il ou elle éprouve par la grâce de Dieu, au point de vouloir en faire le point d’appui de l’engagement de sa vie à cause du Christ, et qu’en assumant cette générosité, il lui donne une mission spécifique, l’ordonnant à ce travail du dialogue.
Cela permet alors de préciser l’enjeu et le fondement de la spiritualité de l’Ordre, c’est-à-dire son « inspiration », dont j’identifie trois caractéristiques, plus une, fondamentale.
La Parole de Dieu, une base essentielle
La base de tout est la Parole de Dieu en tant qu’elle est précisément le lieu, la manière, la modalité, la réalité de Dieu qui s’adresse à l’humanité qu’Il a créée. Lorsque l’Ordre nous initie et nous encourage à la « lectio divina », il ne nous demande évidemment pas seulement d’appliquer notre raison à la connaissance et à la compréhension des textes de l’Ecriture. Il ouvre devant nous le chemin sur lequel l’intelligence rationnelle qui lit l’Ecriture descend dans le cœur, découvrant que cette parole écrite est en fait une Parole que Dieu adresse à l’homme, qu’Il nous adresse comme Il l’adresse à tout homme. Ainsi nous sommes invités à nous tenir en la présence d’un Dieu qui parle.
Cette base n’est-elle pas essentielle pour des hommes et des femmes qui vont se former à parler eux-mêmes, et auront à toujours se souvenir que le premier qui parle dans ce monde est Dieu ?
Le dialogue de Dieu avec l’humanité
La recherche de la vérité
Nous sommes des hommes et des femmes saisis par le mouvement – oblique et descendant – par lequel Dieu veut entretenir le dialogue avec l’humanité : lorsque nous parlons de « recherche de la vérité », nous devons prendre conscience que c’est au sein de ce dialogue, et porté par lui, que s’élaborent les discours humains qui balbutient des mots que Dieu veut parfois bien emprunter pour révéler sa présence.
L’Ordre des prêcheurs est, en quelque sorte, un Ordre du « Dieu qui vient » dans l’humanité. Il ne vient pas d’abord pour faire la part des choses ou la part des justes, mais Il vient pour y parler et s’adresser à l’humanité.
Lorsque nous parlons de recherche de la vérité, nous parlons de cette compréhension progressive à laquelle nous voudrions aiguiser notre intelligence en même temps que notre cœur : Dieu vient dialoguer avec l’humanité et c’est au sein de ce dialogue et porté par lui que vont s’élaborer des discours humains qui vont balbutier des mots que Dieu, parfois, va bien vouloir emprunter pour révéler sa présence miséricordieuse aux hommes.
C’est la raison pour laquelle nous pouvons dire qu’une condition importante de la prédication est l’écoute. Il ne s’agit pas d’une écoute de type psychologique, ni même spirituelle. C’est simplement l’écoute de celle ou celui qui parle de sa vie ; écoute de celui ou celle qui, en étant ainsi écouté, a des chances de comprendre que dans ce récit il pourra peut-être découvrir que Dieu s’adresse à lui.
Autrement dit, ce n’est pas celui qui écoute qui va adresser une parole de la part de Dieu, et c’est un renversement important : il s’agit d’une Parole écoutée à deux, de la Parole de Dieu qui s’adresse à quelqu’un dans sa vie, qui s’adresse à un groupe, à une communauté, qui parle dans la vie de l’Eglise. Nous sommes des hommes et des femmes saisis par le mystère de ce mouvement de Dieu qui s’adresse à l’humanité.
La Parole de vérité
Un seul « discours » en effet est par lui-même Parole de vérité, et c’est le mouvement de la venue du Fils de l’homme en amitié avec l’humanité. Cette venue révèle en plénitude qui est Dieu, « ce qu’Il est » : dialogue avec l’humanité qu’Il a créée.
C’est dans ce dialogue entretenu que le Fils révèle qu’il est le Fils du Père et, par là même, quelle est la destinée de l’homme, appelé à tenir sa place propre dans le dialogue avec son Dieu. Le premier point serait la vérité n’est ainsi pas d’abord la vérité dogmatique ; cette dernière, importante, est le discours à travers lequel l’homme tente d’exprimer ce qu’il perçoit, – à un moment donné et au sein de la communauté des croyants de son Eglise,- de la vérité de Dieu. La vérité que nous cherchons est, si l’on peut dire, plus simple : elle a une figure, cette vérité est « Quelqu’un ». Lorsque nous désirons être « chercheurs de la vérité », nous ne cherchons pas les bonnes théories sur Dieu, ni les livres les plus savants. Nous cherchons plutôt à nous laisser dessaisir de ces « approches de la vérité » pour que l’intelligence comme le cœur soient saisis par cette révélation du Christ venant dans ce monde. L’humilité du chercheur de Dieu est de s’effacer devant cette vérité de Celui-là qui vient.
Au service du dialogue
Ainsi donc se précise ce qui constitue la tâche première de l’Eglise : devenir sans cesse « ministre » de ce dialogue dont prend l’initiative Celui qui vient et est la vérité du monde.
L’Ordre, qui veut se tenir au cœur de l’Eglise et y servir, aurait alors cette tâche particulière d’être au service de ce ministère précis de l’Eglise qui est de servir le dialogue de Dieu avec les hommes, de servir la vérité de la Parole que Dieu adresse au monde.
On m’a récemment fait remarquer la différence entre les sites évangéliques sur Internet et les sites de l’Eglise catholique, et ce pourrait être pour nous comme un « rappel à l’Ordre » : très souvent, les premiers accueillent l’internaute et dialoguent avec lui ; là où les seconds, trop souvent, parlent à l’internaute à qui ils cherchent d’abord à délivrer un message. Même si, bien souvent, ce qui est transmis en terme de connaissance sur les sites catholiques est fort intéressant, et important, la « manière » d’entrer en dialogue, et la place faite à ceux à qui on voudrait s’adresser, pose une question.
A la base de la mission de l’Ordre, il y a donc la Parole de Dieu, méditée en sorte que nous puissions accepter d’être dessaisis de nos discours, nous laissant à notre tour saisir par ce mouvement de Dieu qui vient s’adresser aux hommes. C’est ainsi qu’on peut être habité par la révélation que cette vérité que nous cherchons est le Christ, Dieu qui vient dialoguer avec l’humanité. Là serait l’inspiration de l’Ordre des prêcheurs.
La mission, moins un contenu qu’une dynamique
Des priorités
Depuis au moins le chapitre général des frères à Quezon City, en 1977 (reprises explicitement par le chapitre de Walberberg en 1980), des priorités ont été définies pour la mission de l’Ordre. Nous les connaissons bien, pour les décliner souvent, parfois comme une sorte de « mantra » magique. Ce sont :
- la catéchèse au sein des cultures et des lieux éloignés de la foi chrétienne ;
- la politique culturelle de l’Ordre, qui pourrait se définir encore comme la vie d’étude ;
- la justice sociale ; les moyens de communication sociale.
Précisons un peu les enjeux de ces priorités, toujours actuelles pour l’Ordre.
Première priorité : la catéchèse au sein des cultures et des lieux éloignés de la foi chrétienne
La première priorité est donc « la catéchèse au sein des cultures et des lieux éloignés de la foi chrétienne. « De toutes les nations faites des disciples » : c’est important que nous l’entendions, nous qui sommes au moins dans les lieux de la vieille Eglise, parce que la tendance aujourd’hui des Ordres anciens portés à être habitués et accoutumés à prêcher à ceux qui ont envie de nous écouter prêcher.
Aujourd’hui, autour de nos couvents, se réunissent pas mal de gens qui se retrouvent dans la manière que nous avons de célébrer, de rencontrer, de parler de Dieu. Se constitue ainsi comme un réseau dominicain assez solide et qui est un bon réseau d’amitié, et c’est bel et bon.
Mais nous ne devons pas oublier que l’Ordre dit « une des priorités c’est d’annoncer la parole de Dieu dans les cultures et dans des lieux où cette foi chrétienne n’existe pas, n’est pas implantée ». Ne faut-il pas entendre un appel ? Oser sortir de nos lieux établis, non pas parce qu’ils n’auraient pas d’importance, ni qu’il ne faudrait pas entretenir la vie de l’Eglise telle qu’elle existe, ni qu’il ne faudrait pas enseigner aux gens qui viennent chercher un enseignement de l’Eglise catholique, ni qu’il ne faudrait pas accompagner des mouvements de l’Eglise. Mais si l’Ordre prend la peine de rappeler cette priorité d’aller dans les lieux et les cultures éloignés de la foi chrétienne, c’est peut-être tout simplement parce qu’il n’y a pas assez de frères qui le font. Nous devons sans cesse réévaluer notre mission à la lumière de cet appel.
Deuxième priorité : la politique culturelle de l’Ordre, ce qu’on pourrait aussi désigner par la mission de l’étude
La deuxième priorité est énoncée sous l’expression de « la politique culturelle de l’Ordre, ce qu’on pourrait aussi désigner par la mission de l’étude ». Nous l’avons dit : nous voulons étudier la vérité de Celui qui est ce mouvement de Dieu venant dialoguer avec l’humanité. C’est une dimension essentielle de notre mission.
Mais comment faut-il s’y prendre pour ce faire ? Une tentation aujourd’hui pourrait être d’être hanté par l’inquiétude que le monde ne va pas bien, qu’il a perdu les connaissances minimales qui constituaient le socle de sa culture, qu’il est non pas tant « interculturel » mais « déculturé », au point même que le discours de l’Eglise et son langage ne sont plus compréhensibles. Il faudrait donc à la fois conserver ce patrimoine culturel, le travailler, et le tenir prêt pour le moment où l’on fera à nouveau appel à lui.
Face à cette tentation, ne convient-il pas de s’interroger sur cette fameuse « rupture » de communication, étrangeté des langages ? On sait bien que l’histoire des langues montre qu’elles évoluent dans l’histoire, à la mesure où elles s’exposent au dialogue avec des gens qui ne parlent pas la même langue. Si l’Eglise devait se contenter de faire des séminaires et des colloques, des réunions et des masters, pour trouver le bon discours à tenir pour pouvoir être comprise du monde, je crains qu’elle perde son énergie. Le défi est d’aller « parler à ceux qui ne parlent pas notre langue » parce que c’est ainsi que la langue va changer, puisqu’elle va essayer de parler avec une autre, elle va se conjuguer avec une autre : il faut, en quelque sorte, « créoliser » la langue de l’Eglise, la « métisser » pour qu’elle puisse être porteuse de la dimension du dialogue.
Ainsi se dessinerait une autre attitude que le « découragement d’un monde perdu ». Il s’agit de dire : le monde va comme il va, et ce monde est aimable. Il est par principe aimable et en tout cas il est aimé de Dieu, puisqu’il est ce monde dans lequel et avec lequel Dieu veut dialoguer.
C’est donc en dialoguant avec les idées de ce monde, aujourd’hui, qu’il faut apprendre à comprendre quelle est cette vérité qu’est le Christ venant dans ce monde aimable bien que déculturé. Notre étude n’est pas une étude de gardien de patrimoine, notre étude n’est pas une étude de bibliothécaire qui conserverait le patrimoine de sorte qu’un jour il puisse à nouveau le mettre – de manière élitiste – au service d’une invention culturelle intelligente nouvelle. Notre étude est une étude qui elle-même doit être en dialogue, qui elle-même doit être en contexte, et plutôt que de faire des séminaires de l’Eglise sur la déculturation de ce monde il vaudrait mieux que l’Eglise accepte de participer aux séminaires de ce monde, déculturé, et de dialoguer avec les hommes et les femmes de ce temps qui essaient de comprendre les enjeux de ce monde, qui essaient de comprendre les grands axes de construction de ce monde. Autrement dit, une Eglise qui se déploie comme dialogue avec le monde scientifique, avec les créateurs culturels d’aujourd’hui, avec la culture des banlieues… Entendons bien : non une Eglise établie quelque part qui cherche à entrer en discussion avec d’autres, mais une Eglise qui assume le fait qu’elle devient dans ce dialogue. Autrement dit, il faut que notre étude soit une étude qui se conjugue avec toutes celles et tous ceux qui essaient d’étudier les grands axes de ce monde.
C’est probablement une des questions qui est posée à notre Ordre, porteur de cette si grande tradition thomiste, essentielle non seulement en terme scientifique mais aussi en ses liens avec la vie, la prière, l’humanité et son devenir. Mais nous avons un immense travail à faire, y compris sur nous-mêmes, pour que cette grande tradition ne soit pas réduite à un patrimoine « autiste », pour qu’elle débatte avec d’autres, qu’elle ose s’exposer à la critique, qu’elle ose devenir toujours davantage vivante en s’exposant au dialogue critique. Et il en est probablement de même pour tout travail théologique.
Troisième priorité : la justice sociale
La troisième priorité est celle de la justice sociale, avec tous les échos que le synode de 1971 par exemple disait « le combat pour la justice et la paix est partie intégrante de l’annonce de la bonne nouvelle du royaume de Dieu ».
Je me souviens que dans les années 80, dans les colloques « Justice et Paix » que nous organisions en Famille dominicaine, une question difficile était la suivante : si le combat pour la justice et la paix est partie prenante de la prédication du Royaume de Dieu c’est donc que cela a quelque chose d’essentiel pour la mission de prédication tout simplement, et donc pour la mission de l’Ordre des Prêcheurs.
Néanmoins, nous devons bien constater que dans notre Ordre nous avons des vedettes de la justice sociale et nous les aimons; nous « vedettarisons » volontiers les hommes et les femmes qui sont engagés pour la justice sociale, et c’est un risque. C’est comme si nous ne réussissions pas :
- d’une part à voir que bien des hommes et des femmes de cet Ordre, de façon simple, humble, silencieuse et modeste, sont des acteurs de la justice sociale, de proximité ou non,
- et d’autre part, comme si nous avions du mal à assumer collectivement le fait que, tant qu’il y aura des humiliés dans ce monde, tant qu’il y aura des victimes de l’injustice sociale, quelque chose de l’alliance ne sera pas en bonne voie de réalisation, quelque chose de l’urgence de la prédication de la Parole de Dieu comme bonne nouvelle restera à faire, et donc quelque chose d’essentiel de notre mission restera inachevée.
De cette simple énumération, dont nous sommes parfois, avouons-le, assez éloignés, que pouvons-nous retenir ?
Il me semble qu’on peut – et c’est finalement ce qu’a fait implicitement le chapitre de Bogota en 2007 – discerner derrière ces priorités l’inspiration évoquée pour introduire ces propos.
L’Ordre est invité à se faire ami des hommes à cause de Celui dont il a charge d’évangéliser la Parole et qui, pour faire entendre le discours de vérité qu’Il est, se fait lui-même ami des hommes. Il faut « aimer le monde » (titre du chapitre des Actes de Bogota consacré à la vie apostolique).
- Aimer le monde, le considérer comme aimable, c’est-à-dire d’abord estimer l’intelligence humaine qui s’y déploie (cela fait partie de la contemplation de la beauté de la création), l’écouter, chercher à la comprendre, dialoguer avec elle, élaborer avec tous une recherche inlassable, mais humble, de la vérité.
- Aimer le monde et apprendre à en connaître les mutations culturelles, ce dont est particulièrement révélateur le monde d’Internet et des multiples moyens de communication sociale : d’une certaine façon, on pourrait ici parler des diverses figures de la globalisation du monde, dont Internet est à la fois un signe et un acteur. Il s’agit d’aimer le monde dans la dynamique globale de son évolution, ses richesses et ses fractures, la créativité magnifique et la capacité de destruction terrible qui peut aussi se déployer.
- Mais aimer le monde, c’est aussi déployer un amour à visée universelle, ce qui explique l’appel à cette priorité de l’évangélisation : nous n’avons pas fini de mesurer l’exigence de l’appel à la mission « ad gentes ». Il est essentiel de ne pas nous limiter au monde de proximité, au monde que nous construisons autour de nous : ouvrir ce cercle de proximité de l’Eglise pour ouvrir cette dernière à l’universalité du monde. Et toujours, au coeur de cet amour du monde, il y a comme une sorte de priorité des priorités, celle de la justice sociale, de l’exigence de la justice ouverte, et offerte, à tous, de la nécessité de la justice comme combat, s’il est vrai que sans la justice il ne peut y avoir la paix.
Le signe le plus déterminant et le plus décisif de notre mission n’est-il pas, finalement, le signe de l’alliance ? Souvenons-nous que lorsque, dans la Bible, l’homme demande à Dieu de dire son Nom, Il répond en donnant son adresse : là où il faut aller pour ne pas laisser l’alliance se clore sur elle-même, auprès du pauvre, de la veuve et de l’orphelin, de l’émigré et de l’étranger, de ceux qui ne comptent pour personne sinon pour Dieu leur Créateur et défenseur. C’est en se déplaçant ainsi du côté de la marge de l’histoire que l’on se tient dans l’histoire comme une sorte de garant de l’incessante ouverture de l’alliance : élargis ta tente, dit l’Ecriture. C’est probablement cette inspiration qui animait le frère Vincent de Couesnongle lorsque, méditant sur la mission de Dominique, il la déclinait selon ce qu’il a nommé les « trois cris » de Dominique : pas sans les pauvres (la vente des livres pour l’aumône) ! pas sans les chercheurs de Dieu et les pécheurs (que vont-ils devenir ? le temps de l’auberge) ! pas sans ceux qui sont loin (le tourment des Cumans) ! Etre gardiens, « veilleurs » de et pour l’alliance, c’est être sans cesse habité par le tourment de ces trois cris.
Des frontières
Mais, de ces priorités, il faut aussi retenir qu’elles ne consistent pas à définir un « programme » de mission. En lisant les Actes des chapitres depuis plus de trente ans, il me semble surtout que ces priorités sont en quelque sorte une traduction des questions de nos contemporains, qui constituent autant de défis pour que l’annonce de la venue du Fils ami des hommes soit véritablement reçue comme celle d’une bonne nouvelle.
Ces questions sont celles de la mondialisation qu’il s’agit d’humaniser (Providence, 2001), de la rencontre, voire de la confrontation des religions et des cultures, des restructurations sociales et politiques provoquées par le monde économique du marché et de la finance, des conflits nombreux qui ressortissent des nationalismes, tribalismes, racismes et provoquent violence et peur (Caleruega, 1995), des difficultés de l’inculturation, de la tension entre sécularisation, quête spirituelle et subjectivisme (Mexico, 1992).
Autrement dit, la tâche première de la mission n’est pas de réaliser un programme mais d’entendre des questions, d’une certaine manière de faire en sorte que ces questions soient non seulement au cœur du dialogue entretenu dans l’humanité, mais qu’elles deviennent le « tourment » de la mission.
C’est, à mon avis, de ce tourment que parlait le chapitre d’Avila, en 1986, lorsqu’il a développé la notion de mission sur les frontières (ce que le frère Pierre Claverie avait, à sa manière et dans le contexte si difficile qui était celui de l’Algérie à ce moment).
Permettez-moi de rappeler les traits principaux de cette mission aux frontières, ici encore non pour nous « vanter » d’être ainsi situés dans le monde (ce qui reste finalement encore assez exceptionnel), mais pour prendre ensemble conscience de la posture en laquelle nous tenir en ce monde.
A ce propos, il est bon de rappeler que dans le cadre de la promesse d’alliance faite par Dieu, ce dernier a une manière particulière de répondre à qui lui demande son nom : plutôt que de dire son nom, écrivait le frère Bernard Rey, Il indique plutôt son adresse : du côté de ceux qui sont mis à l’écart de l’humanité, solidaire du pauvre, de la veuve et de l’orphelin, figures des humains qui risquent le plus, à cause précisément de leur fragilité et de la précarité de leur vie sans assurance, d’être non seulement oubliés mais encore humiliés et maltraités.
Les frontières désignées pour la mission de l’Ordre ne seraient-elles pas comme des indications de l’adresse à laquelle il est préférable d’habiter pour se tenir « veilleurs d’alliance » ?
Cinq frontières, vous vous en souvenez, sont décrites :
- les frontières entre la vie et la mort, manifestant combien la justice et la paix sont un défi dans le monde, et précisément un défi pour qui veut annoncer l’Evangile de la paix (le combat pour la justice et pour la paix sont partie intégrante de la prédication de l’Evangile, disait le Synode des évêques en 1971) ;
- les frontières entre l’humain et l’inhumain, soulignant la réalité des « exclus » comme un défi pour tous ;
- les frontières de l’expérience chrétienne, affrontée au défi des religions universalistes, non pas seulement parce que ces dernières entreraient en débat contradictoire ou conflit avec elle, mais aussi parce que l’universalisme est un horizon que tous devraient apprendre à soutenir ensemble d’un regard convergent ;
- les frontières de l’expérience religieuse mise au défi des idéologies séculières, dont nous devons bien reconnaître qu’elles ne sont pas seulement extérieures à nous mais traversent la conscience contemporaine et marquent profondément l’habitation du monde de tout un chacun ;
- les frontières de l’Eglise, dont il conviendrait de dire qu’elles sont à la fois celles qui séparent des religions non catholiques (et l’œcuménisme est, de ce point de vue, un appel essentiel pour le prêcheur de l’Evangile), mais aussi parce que de telles frontières s’instaurent au sein même de l’Eglise, entre les tendances classiques et progressistes, entre les tenants d’une discipline absolue et celles et ceux qui sont exclus par cette discipline alors même qu’ils avancent sur un chemin de conversion…
Où et comment trouver la force et la vaillance pour se tenir sur ces frontières ? Cette question mérite d’être considérée car, même si nous sommes capables de formuler et tenir ensemble ces perspectives enthousiasmantes, nous savons aussi qu’il peut être difficile d’y rester fidèle. Rappelons-nous qu’il ne revient à personne de se déclarer lui-même prophète, mais qu’il peut être reconnu comme tel par d’autres, précisément ceux et celles qui témoigneront du lieu où l’alliance a été promue.
Reprenons, pour en préciser les enjeux, les cinq frontières qui viennent d’être nommées.
Première frontière : frontière entre la vie et la mort
où la tentation de l’idolâtrie, aliénant la liberté des enfants de Dieu et la vérité de Dieu qui veut parler aux hommes, est la plus forte.
Etre prêcheur, c’est se mettre dans cette perspective d’être serviteur du dialogue dont l’Eglise est le ministre à cause du Christ.
Les cinq frontières, d’une certaine manière, sont des indications qui nous aident à nous souvenir des raisons pour lesquelles nous reconnaissons le Christ comme notre Seigneur, le Seigneur de la vie, Dieu venu dans le monde pour dialoguer avec l’humanité, adressant ainsi la Parole du Père au monde, mis à mort par des hommes et relevé d’entre les morts par Dieu. Pourquoi a-t-il été tué ? Non parce qu’il était un politique révolutionnaire, ni parce qu’il faisait partie des pauvres de ce monde, ni parce qu’il déstabilisait à lui seul le pouvoir romain. Il a été mis à mort au terme d’un procès manipulé par certains de ceux qui se pensaient gardiens de l’alliance. Il a été mis à mort de l’intérieur même de son monde, parce qu’il disait qu’il ne fallait pas se tromper de Dieu, qu’il ne fallait pas tromper les hommes en se réclamant de Dieu car, ce faisant, on trompait Dieu. Voilà qui est une perspective pour tout chercheur de la vérité.
Autrement dit, Jésus voulait rappeler que ce n’est pas parce qu’on sait comment s’adresser à Dieu, qu’on peut, au nom de Dieu, imposer à ceux qui en ont moins les moyens et font confiance à leurs « guides » la figure de Dieu, les commandements de Dieu, et la manière de se comporter avec Dieu qu’on veut et souvent construit à sa propre image. Ce n’est pas parce qu’on est ministre de Dieu qu’on peut imposer aux autres la façon dont il faut qu’ils soient serviteurs de Dieu. Jésus a été tué parce qu’il a combattu l’idolâtrie au sens le plus fort du terme, c’est-à-dire cette attitude par laquelle, ceux qui sont chargés par Dieu d’être ministres de son dialogue avec ce monde, se mettent à tenir un discours sur Dieu dans ce monde qui risque d’empêcher ce dernier d’entendre la parole que Dieu est venu lui adresser. Terrible chemin que celui de la vérité !
Pour le prêcheur, l’exigence de ce chemin, le rappel de ce qui a conduit le Fils de Dieu à s’exposer lui-même au refus et à la mort, doivent être comme un appel à vérifier sans cesse comment son ministère de prédication lui permet d’articuler, de la manière la plus juste possible, la liberté des enfants de Dieu et la vérité qui veut se révéler à eux.
Articuler la liberté des enfants de Dieu – cette liberté par laquelle Dieu fait l’homme capable de Dieu – avec la vérité de ce Dieu qui veut parler aux hommes, Fils de Dieu venu parmi les hommes.
Tel pourrait être un critère de la mission. Promouvoir la liberté des hommes, pour que puisse s’y entendre la vérité de Dieu qui vient libérer encore plus en vérité cette liberté. C’est sur cette base, et en dialogue avec cet engagement contre toute tentative d’idolâtrie, que peut au mieux se déployer la recherche, le travail théologique. Ainsi suivrons-nous l’exemple donné par les premiers frères arrivés à Hispaniola et les théologiens de l’école de Salamanque. Les « frontières » dont parle notre Ordre sont des lieux où, peut-être, se fait plus prégnant de risque de l’idolâtrie et, de ce fait, plus urgent le combat humain et intellectuel qui résiste à l’aliénation de la vérité en prenant précisément le parti de la liberté des hommes.
Quand on dit qu’il est important que l’Ordre prêche aux frontières entre la vie et la mort, on ne veut pas simplement faire du romantisme, ni seulement se lamenter sur les trop nombreux lieux de mort dans ce monde, ni se déclarer soi-même capable d’affronter ces lieux de mort et d’y combattre ce qui écrase l’humain. On cherche plus simplement à signifier qu’il est des lieux où ces fractures entre ceux qui profitent de la vie et ceux qui sont exposés dans leur vie, à la mort, sont particulièrement violentes et invitent d’autant plus à chercher comment articuler au mieux la liberté des enfants de Dieu et la vérité de Dieu qui fait aimer ces enfants.
Plus encore, on dit que, bien souvent, c’est sur de tels lieux de fractures entre la vie et la mort qu’il y a tentation d’idolâtrie, tentation de dire à ceux qui sont les plus exposés à la mort comment il faut qu’ils fassent pour s’en sortir, ou a ceux qui sont du côté de la vie comment il faut qu’ils fassent pour s’occuper de ceux qui sont morts. A prendre la parole pour dire aux gens comment il faut qu’ils fassent pour vivre, alors que notre tâche de ministre du dialogue est de reconnaître que dans ces lieux de fractures il y a de la liberté humaine avec laquelle il s’agit de dialoguer pour la rejoindre là où elle est plus fulgurante, là où elle sait qu’elle est créée par Dieu. Alors la liberté humaine peut chercher à s’ajuster à la vérité de la parole de Dieu venu dans le monde pour s’adresser aux hommes et, ainsi, les sauver.
En ces lieux de fracture, donc, il ne s’agit pas de porter des jugements, ni d’exhorter ceux qui seraient du côté de la vie à faire davantage attention à ceux qui sont exposés à la mort. Certes, il faut bien tenir une telle position, mais il nous faut d’abord, nous-mêmes, nous approcher de ce lieu de fulgurance où se conjoignent liberté de l’homme et vérité de Dieu.
A la suite du Christ, le chemin d’une telle approche est celui de l’amitié (« je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis »), l’amitié constituant alors comme l’élément matériel du sacrement de la fraternité, cette dimension humaine que, par la grâce de l’Esprit, Dieu pourra, s’il le veut, transfigurer, rendant impossible l’aliénation de Dieu.
Seconde frontière : frontière entre l’humain et l’inhumain
La seconde frontière est celle entre l’humain et l’inhumain, en particulier en ces lieux modernes de l’exclusion. Je propose de nommer cette deuxième frontière celle de la réalité des humiliations.
L’une des réalités du monde d’aujourd’hui est que, partout, il y a des hommes, des femmes et des enfants, des individus et des groupes, des identités et des réalités culturelles, qui sont humiliés dans le grand mouvement du monde. Par exemple, en France, on peut déplorer qu’une population nombreuse de jeunes, hommes et femmes, dont tout le monde prédit (et les réunions savantes ne manquent pas à ce sujet) que, faute d’avoir reçu la transmission confiante des traditions culturelles et du patrimoine de la langue et de la connaissance au cours de leur éducation, ils peineront toujours à accéder au plus de leur liberté. Ils risquent ainsi de ne pas avoir accès à la vie du monde telle qu’elle tourne et, plus les années passeront, ils ressentiront comme une humiliation qui leur est faite.
Or, l’humiliation prépare la violence et n’est pas la posture la plus humanisante. Faute de bienveillance et de confiance, faute aussi d’avoir mis en pratique le principe selon lequel il faut, pour amoindrir l’injustice entre des groupes, donner priorité à ceux qui ont le plus besoin d’être reconnus et intégrés, voilà une part d’humanité poussée en déshumanisation. Ici encore, c’est l’amitié tissée avec ces « non reconnus » qui permettra de rejoindre ce lieu fulgurant de la liberté humaine où peut jaillir la vérité de Dieu. Au prêcheur de s’exposer ainsi à lier son propre destin à celui des humiliés dans ce monde. Reconnaissons que ce n’est pas là chose toujours facile, tellement nous pouvons être « installés » dans nos évidences, sans voir passer tout près de nous celles et ceux qui meurent de n’être reconnus par personne ! Souvenons-nous de Jésus dont on s’étonne de le voir frayer avec des « gens de peu »…
Troisième frontière : frontière de l’expérience chrétienne mise au défi des religions universalistes
La troisième frontière est celle de l’expérience chrétienne. Elle est souvent rappelée dans les Actes de nos Chapitres qui soulignent dans le monde contemporain le défi des grandes religions universalistes. A nous, ici, d’être attentifs a ce que nous disons du défi des ces religions universalistes.
Le risque, ici, est bien sûr celui de l’indifférence, mais aussi celui de la caricature. En France, par exemple, nous risquons d’être aveuglés par les extrémismes qui se réclament de l’islam, et d’en oublier la force et la beauté de l’expérience humaine, religieuse et mystique dont l’islam est porteur. On peut être aveuglé par les critiques souvent trop faciles du fondamentalisme de certains Evangélismes. Mais, pour l’expérience chrétienne, la confrontation aux religions universalistes est une chance à saisir, qu’il y a à apprendre du rapport à Dieu, au monde, à sa destinée de chacune d’entre elles. Cette confrontation critique devrait aussi aider les christianismes à se laisser désinstaller pour estimer la quête de Dieu d’autrui, de sorte qu’on puisse, à travers amitié et dialogue, se laisser conduire, les uns et les autres, loin des chemins identitaires, fondamentalistes ou violents qui, de part et d’autre et par la force subreptice de la « déculturation », peuvent à leur tour devenir idolâtres, et s’ouvrir vraiment à la portée universelle de notre religion.
Quatrième frontière : frontière de l’expérience religieuse mise au défi des idéologies séculières
La quatrième frontière est celle de l’expérience religieuse mise au défi des idéologies séculières.
Peut-être faudrait-il ici parler davantage des dynamiques séculières d’oubli ou de relégation de Dieu dans la seule sphère de l’intime, de certaines logiques, économiques, sociales ou politiques, d’organisation des sociétés humaines.
Est-il possible durablement que les convictions religieuses soient ainsi enfermées dans la sphère de l’intime ? Est-il possible que les systèmes de convictions religieuses, et les argumentations de leur tradition intellectuelle, soient exclus du débat par lequel nos contemporains ont à argumenter de manière critique les éléments à promouvoir d’un monde soutenable par tous ?
Loin de constituer une collusion dangereuse entre le politique et le religieux (la tentation peut toujours à nouveau surgir, cependant, et il faut veiller à y résister : ici encore, la question est celle de l’idolâtrie), il s’agit plutôt d’avoir l’audace de proposer à tout un chacun d’être pleinement impliqué dans le débat social pour le bien commun de tous.
Cinquième frontière : frontière de l’Eglise
Enfin la dernière frontière est celle des frontières de l’Eglise.
On peut évidemment développer ce thème en parlant des divergences entre les Eglises chrétiennes, et il y a ici un défi majeur pour la crédibilité des chrétiens. Mais il faut aussi entendre les frontières à l’intérieur même des Eglises où, sous prétexte de particularisme culturel, d’identité propre, de grandeur du patrimoine culturel et intellectuel, les tensions
entre Eglises peuvent se faire vives. Ici encore, le risque est celui de l’idolâtrie et l’enjeu est donc, à nouveau, de rejoindre, par delà les tensions et divisions, la liberté et la personne pour la promouvoir dans sa plus grande fulgurance de sorte que la vérité de la parole de Dieu adressée aux hommes se manifeste.
Un tel enjeu existe aussi dans notre propre Eglise catholique ; songez aux discussions que nous avons effleurées sur les différentes identités dans notre Eglise, sur les personnes qui sont en situation difficiles par rapport à la discipline de l’Eglise, songez à la situation de ces hommes et ces femmes qui aujourd’hui dans l’Eglise catholique considèrent, à tort ou à raison, que leur seule place possible est le seuil, non seulement parce qu’ils sont en situation de discipline difficile mais aussi parce qu’il ne comprennent pas de quoi l’Eglise veut parler, parce qu’ils ne sont pas d’accord avec la façon dont elle se situe, parce que ils sont choqués par les scandales. Bref, il y a dans notre Eglise des fractures qui sont en train de se manifester. Ces fractures, ou bien nous allons les considérer comme des raisons de désolation, et encore une fois nous tenir du côté du centre, même si nous chercherons à aider les personnes concernées à partir de leur situation réelle (mais sans engager à une position « schizophrène »), ou bien nous allons chercher à ouvrir le centre à considérer que la communion doit aller le plus large possible, parce que l’alliance doit aller le plus large possible.
Car l’enjeu de cette frontière, comme des quatre précédentes, est toujours bel et bien celui de la communion dans une même espérance de l’alliance.
Une méthode
La méthode apostolique en 3 étapes, la réponse dominicaine en 3 dimensions
Pour rejoindre cette « adresse » (gardant ici à l’idée que l’adresse est aussi ce qui permet de « viser juste » !), on voit se dessiner au fil des chapitres généraux quelques indications de méthode.
C’est d’abord la « méthode apostolique » décrite par Caleruega qui se compose de trois étapes : partager la vie, les joies et la souffrance des gens (ce qui souligne l’importance donnée à la rencontre des gens, telle qu’en parlent le chapitre de Cracovie ou celui de Bogota) ; mener une réflexion théologique à partir de ce destin partagé (ce qui n’est pas sans rappeler la pratique qui s’est établie, par exemple, entre Las Casas et Vitoria et les théologiens de Salamanque) ; élaborer alors, mais alors seulement, l’un ou l’autre projet concrétisant la mission.
Le même chapitre de Caleruega décrit alors trois dimensions de la réponse dominicaine : la pauvreté et la prédication aux frontière, insistant donc sur la communauté de destin (on peut ici rappeler les raisons pour lesquelles, semble-t-il, Dominique a choisi l’état de déréliction du « mendiant » pour partir et envoyer prêcher) ; l’itinérance, afin d’éviter l’installation stérilisante mais aussi pour rester vigilant aux mouvements du monde ; le choix décisif du dialogue comme modalité de la rencontre (dialogue oecuménique, interreligieux et culturel).
Le chapitre de Providence, quant à lui, ajoute un appel à la vigilance pour que notre témoignage soit crédible. Rappelons ici que c’est bien probablement cette exigence de crédibilité qui était au cœur de la discussion entre Diègue et Dominique et les légats du Pape lors de la rencontre fondatrice de Montpellier (les légats pensaient que tout se déroulait comme il convenait, mais ne comprenaient pas pourquoi leur parole n’était pas reçue : Dominique et Diègue montrèrent alors qu’il s’agissait de laisser les habitudes et les apparats pour se tenir davantage en proximité et réciprocité avec ceux que l’on voulait rencontrer). Cette crédibilité nous appelle à rester attentifs à notre rapport aux richesses, à notre engagement dans la résolution des conflits, au juste équilibre entre l’identité religieuse et les fonctions cléricales et le statut qu’elles confèrent, à la tradition spirituelle et la théologique de l’Ordre.
Bien souvent, nous aimons en quelque sorte « résumer » cette méthode apostolique par le terme d’itinérance, ou de mobilité. Ici encore, permettez-moi de nous mettre en garde sur la facilité avec laquelle nous risquons de définir une mobilité qui serait exactement à l’image des déplacements que nous souhaitons faire (c’est en tout cas le risque, à mon sens, pour les frères qui pensent plus volontiers l’itinérance en fonction de la mission individuelle de chacun que d’un point de vue plus global).
Détour par l’anthropologie de la mobilité
Pour nous aider à mesurer à quoi engage cette notion de mobilité, je vous propose un bref détour par la réflexion de l’anthropologue Marc Augé (Pour une anthropologie de la mobilité, Coll. « Manuel Payot », Payot, Paris, 2009).
Du concept de frontière
Dans sa réflexion, cet auteur interroge d’abord la notion de frontières, constatant que sa place centrale au cœur de l’activité symbolique qui vise à donner un sens au monde pour le rendre vivable, est en mutation. En effet, ces divisions qui compartimentaient l’espace sont modifiées par le processus de globalisation, ce dernier établissant d’autres types de frontières, ou plutôt de barrières : « De nouvelles frontières se dessinent ou plutôt de nouvelles barrières se dressent, soit entre pays pauvres et pays riches, soit, à l’intérieur même des pays sous-développés ou des pays émergents, entre les secteurs riches figurant sur le réseau de la globalisation technologique et économique et les autres. D’un autre côté, ceux qui rêvent d’une société-humanité et considèrent que la planète est leur patrie ne peuvent ignorer ni la force des replis communautaires, nationaux, ethniques ou autres, qui veulent rebâtir des frontières, ni l’expansionnisme des prosélytismes religieux, qui rêvent de conquérir la planète en bousculant toutes les frontières. Dans le monde “surmoderne”, soumis à la triple accélération des connaissances, des technologies et du marché, l’écart est chaque jour plus grand entre la représentation d’une globalité sans frontières qui permettrait aux biens, aux hommes, aux images et aux messages de circuler sans limitation et la réalité d’une planète divisée, fragmentée, où les divisions déniées par l’idéologie du système se retrouvent au cœur même de ce système » (pp. 13-14).
Il y a donc une sorte d’opposition entre la réalité de la ville-monde où toutes les connexions établies semblent bâtir un monde de plus en plus homogène (méta-cité selon Paul Virilio) et la ville-monde où se retrouvent et s’affrontent différences et inégalités.
Ainsi, repenser les frontières invite à essayer de comprendre ce système de tension entre deux « représentations du monde », et pour ce faire comprendre les contradictions de l’histoire contemporaine. L’analyse de l’auteur est que la représentation globalisée du monde ne doit pas faire croire qu’il n’existe plus de frontières, mais plutôt comprendre quelles sont les nouvelles frontières qui se redessinent : « Nous ne vivons pas dans un monde achevé, dont nous n’aurions plus qu’à célébrer la perfection. Nous ne vivons pas non plus dans un monde abandonné inexorablement à la loi des plus forts ou des plus fous. Nous vivons d’abord dans un monde où la frontière entre démocratie et totalitarisme existe encore. Mais l’idée même de démocratie est toujours inachevée, toujours à conquérir » (p. 16). « Il y a dans l’idée de globalisation, et chez ceux qui s’en réclament, une idée de l’achèvement du monde et de l’arrêt du temps qui dénote une absence d’imagination et un engluement dans le présent qui sont profondément contraires à l’esprit scientifique et à la morale politique » (p. 17).
De l’urbanisation
Dans ce contexte, c’est la notion de périphérie urbaine qu’il faut aussi à nouveau penser, d’un point de vue non plus géographique mais politique et social, posant d’ailleurs à nouveaux frais la question même de l’intégration, et obligeant à tenir compte de l’instauration de ce que le géographe Philippe Vasset nomme les zones blanches (Un livre blanc, Fayard, 2007) qui sont comme des « non lieux » : « Ce sont des espaces où nulle relation sociale ne peut se lire, où nul passé partagé ne s’inscrit plus, mais, au contraire des non-lieux de la surmodernité triomphante, ce ne sont pas non plus des espaces de communication, de circulation ou de consommation » (p. 28).
Ainsi le phénomène d’urbanisation manifeste les dynamismes et les tensions du système de la globalisation : « Dès lors, l’urbanisation se présente bien sous deux aspects contradictoires, mais indissociables, comme les deux faces d’une même pièce : d’une part, le monde est une ville (la “méta-cité virtuelle” dont parle Virilio), une immense ville où travaillent les mêmes architectes, où se retrouvent les mêmes entreprises économiques et financières, les mêmes produits…, d’autre part, la grande ville est un monde, où se retrouvent toutes les contradictions et les conflits de la planète, les conséquences de l’écart grandissant entre les plus riches des riches et les plus pauvres des pauvres, le tiers-monde et le quart-monde, les diversités ethniques, religieuses et autres. […] Le monde-ville et la ville-monde apparaissent comme liés l’un à l’autre, mais de façon contradictoire. Le monde-ville représente l’idéal et l’idéologie du système de la globalisation, alors que dans la ville-monde s’expriment les contradictions ou les tensions historiques engendrées par ce système. C’est à l’articulation du monde-ville et de la ville-monde que se situent les zones vides et poreuses – dont parle Philippe Vasset -, ces zones qui sont la face invisible de la mondialisation ou tout au moins la face que nous ne pouvons, ne voulons et ne savons pas voir » (p. 33-34).
Ces phénomènes aboutissent à un aveuglement des regards, qui se traduit par un brouillage dans le vocabulaire à l’aide duquel on essaie de rendre compte de la réalité observée, la plupart privilégiant le langage spatial.
Ainsi en est-il du mot « exclusion », qui ne saurait indiquer de quelle réalité exactement tels ou tels seraient exclus, ou encore « clandestin » qui désignent souvent des personnes tout à fait identifiées, ou « issu de l’immigration » qui précisément désignent des individus de nationalité française.
Pour l’auteur, la crise des banlieues manifeste un sens plus général, en lien avec ces mutations ; non seulement on a pu observer des violences de bandes, et des rivalités entre elles, mais on s’est trouvé devant l’aspiration de jeunes « révoltés » à la visibilité : « la demande des jeunes gens en révolte n’est pas une demande subversive. Ils veulent être “dans le coup”, consommer comme les autres. Le fait de mettre le feu à des écoles ou à des lieux publics n’a pas plus de signification “révolutionnaire” que celui de faire flamber la voiture de ses voisins de quartier. Ce que l’on veut, c’est d’abord se rendre visible, exister visiblement » (p. 44).
Dans cet effort de compréhension, il faut aussi se méfier de l’usage que l’on fera du mot « culture », ou de la notion de multiculturalisme, tant on peut constater le déficit, précisément, de transmission d’un héritage culturel (lequel, d’ailleurs, n’affecte pas seulement les populations de l’immigration, mais bien plus largement les victimes d’une faillite de la transmission éducative), créant ainsi une situation de « déculturation » : « On parle beaucoup de culture et d’identité de nos jours. Mais culture et identité sont des notions très problématiques lorsque se combinent les effets de la déculturation et de l’analphabétisme » (p. 47). Il s’agit plutôt aujourd’hui de retrouver les voies qui rendront la démocratie accessible à tous : « L’appel au respect ou au dialogue des cultures n’a aucune pertinence dans ce contexte. Il ne concerne en effet ni les fanatiques mobilisés, ni les nouvelles générations d’origines diverses, qui ont créé ou participé à la création de nouvelles cultures urbaines sans référence à une quelconque tradition antérieure » (p. 51).
Toutes ces mutations aboutissent à une mutation de la réalité même de la ville, deux réalités urbaines coexistant : les centres colossaux et l’urbain sans ville qui colonise le monde : « Ce qui est en cause, au total, dans les bouleversements actuels, c’est un déplacement de l’utopie. Même si, historiquement, les deux mouvements se superposent, on peut dire que la migration mondiale se substitue à l’exode rural vers les villes, et que l’opposition Nord/Sud a pris la place de l’opposition Ville/Campagne. Pourtant l’aboutissement de la nouvelle migration, c’est la mégapole à vocation globale qui prétend incarner l’utopie de l’économie libérale, même en régime politique non libéral. […] Le paradoxe de l’époque actuelle, c’est que le développement de la ville semble la faire disparaître : nous avons le sentiment d’avoir perdu la ville, alors même qu’il n’y a plus qu’elle » (p. 76-77). « De ce point de vue, la ville est donc bien une illusion. En tant qu’utopie réalisée, elle n’existe nulle part. Mais les termes de cette illusion (transparence, lumière, circulation) font allusion à ce qui pourrait peut-être exister un jour (un monde unifié et pluriel transparent à lui-même, qui n’existe évidemment pas, n’est même pas concevable aujourd’hui, mais dont l’hypothèse donne un sens ou une illusion de sens à notre histoire). Ce qui se dessine sous nos yeux, avec l’urbanisation du monde, s’apparente ainsi à un déplacement de l’utopie, à l’apparition d’un monde du pressentiment aux dimensions du globe, de la planète, comme la ville en elle-même avait été jadis l’objet de pressentiments et de projections. En ce sens, l’histoire commence ou recommence, mais à une autre échelle » (p. 78-79).
C’est ainsi dans ce contexte qu’il s’agit de penser la mobilité, la penser à diverses échelles pour essayer de comprendre les contradictions qui minent notre histoire (p. 85). Cela implique de penser de manière nouvelle la circulation des hommes, penser le temps sans projeter sur l’avenir des figures révolues du passé : « Penser la mobilité dans l’espace, mais être incapable de la concevoir dans le temps, telle est finalement la caractéristique de la pensée contemporaine prise au piège d’une accélération qui la sidère et la paralyse. Devant l’émergence d’un monde humain consciemment coextensif à la planète tout entière, tout se passe comme si nous reculions devant la nécessité de l’organiser, en nous réfugiant derrières les vieilles divisions spatiales (frontières, cultures, identités) qui jusqu’à présent ont toujours été le ferment actif des affrontements et des violences » (p. 87-88). « La mobilité dans l’espace reste un idéal inaccessible à beaucoup, alors qu’elle est la condition première d’une éducation réelle et d’une appréhension concrète de la vie sociale. La mobilité dans le temps a, quant à elle, deux dimensions très différentes en première apparence, mais assez étroitement complémentaires. D’un côté, apprendre à se déplacer dans le temps, apprendre l’histoire, c’est éduquer le regard posé sur le présent, l’armer, le rendre moins naïf ou moins crédule, le rendre libre. D’une autre côté, échapper, dans toute la mesure du possible, aux contraintes de l’âge est la plus authentique forme de liberté. L’éducation, là encore, est le meilleur garant. Dans toute vraie démocratie, la mobilité de l’esprit devrait être l’idéal absolu, la première obligation. Quand la logique économique parle de mobilité, elle, c’est pour définir un idéal technique de productivité. C’est le point de vue inverse qui devrait inspirer la pratique démocratique. Assurer la mobilité des corps et des esprits le plus tôt et le plus longtemps possible apporterait de surcroît la prospérité matérielle » (p. 90).
Conclusion de l’auteur : « Nous avons besoin d’utopie, non pour rêver de la réaliser mais pour y tendre et nous donner ainsi les moyens de réinventer le quotidien. […] Il faut apprendre à sortir de soi, à sortir de son entourage, à comprendre que c’est l’exigence d’universel qui relativise les cultures et non l’inverse. Il faut sortir du quant à soi culturaliste et promouvoir l’individu transculturel, celui qui, prenant de l’intérêt à toutes les cultures du monde, ne s’aliène à aucune d’entre elles. Le temps est venu de la nouvelle mobilité planétaire et d’une nouvelle utopie de l’éducation. Mais nous ne sommes qu’au début de cette nouvelle histoire, qui sera longue et, comme toujours, douloureuse » (p. 90-91).
La fraternité comme mission de communion
Le thème de la fraternité est, pour notre tradition, au cœur de la perspective de la mission. Lorsque nous parlons de la fraternité, en effet, nous parlons bel et bien de cette appel à nous tenir, individuellement et en communauté, en état d’espérer être rendu capable de fraternité, espérer être engendré à cette capacité : telle est notre aspiration à la conversion.
Nous n’entrons pas en vie commune ou en fraternités parce que nous savons que nous sommes capables de vivre en frères et d’êtres unis : ce serait trop beau ! Nous faisons ce choix parce que nous avons le sentiment fort que se joue là quelque chose de vrai quant à cette conjonction entre Dieu qui s’adresse à l’homme et l’homme qui émerge à sa liberté.
A ce titre, notre manière de vivre en fraternité est partie prenante de notre mission à la condition que nous portions cette aspiration à la communion sans prétendre la posséder jamais. Nous espérons, plus humblement, que cette « approche fraternelle » de la communion nous pousse à espérer une communion qui toujours s’élargirait et s’ouvrirait au-delà des limites de notre propre tente installée, même dans la charité. Une communion universelle.
Vivre en fraternité c’est toucher du doigt cet appel à élargir notre tente, aspirer à ce que ceux qui sont hors de l’alliance consciente viennent rejoindre ceux qui pensent en être les gardiens pour développer avec eux encore davantage d’ouverture, davantage d’hospitalité, davantage d’espérance de la communion universelle. Vivre en frère pour être engendrés à notre pleine capacité d’espérance en cette communion.
Une fraternité, à ce titre là, doit être d’abord disponible pour l’hospitalité et l’accueil. Nous pouvons parfois être tentés de penser que notre fraternité est bien installée et n’a besoin de personne, ou que notre communauté ne peut pas accueillir tel ou tel frère qu’on voudrait lui assigner car elle a établi son bon équilibre. On pense alors posséder notre fraternité à la mesure de l’équilibre qu’on y a établit.
Mais oser accueillir du nouveau (et, il faut bien ici être réaliste, avec un certain discernement), c’est être prêt à ce que quelqu’un de nouveau puisse être fait cohéritier de ce que nous croyons posséder, puisse apporter un nouveau regard sur la réalité et le devenir, sur les ouvertures nécessaires, puisse développer une idée nouvelles sur la lecture de l’exigence de la mission aux frontières et les priorités, puisse aussi proposer une interprétation nouvelle de la Parole de Dieu. Bref, faire hospitalité c’est être prêt à tout recommencer. Le signe de la fraternité c’est le signe qu’il n’y a pas de communion établie entre des frères et des sœurs qui auraient quoi que ce soit à craindre en s’ouvrant à quelqu’un de nouveau. Il n’y a rien à craindre à être pris au sérieux dans son espérance de communion.
Notre mission propre de fraternité est d’être capable de dire que nous dépensons toute notre énergie pour que cette petite Eglise particulière qu’est une fraternité soit heureuse, et que parce qu’elle est heureuse, elle n’ait pas peur de s’ouvrir à un plus grand particulier, de ce plus grand particulier à un plus grand encore. De signifier ainsi, et d’abord à elle-même, son espérance de l’universel.
Si nous vivons cette réalité-la dans l’Eglise en tant que serviteur de ce dialogue qui est l’essence de l’Eglise, alors nous apporterons dans cette Eglise un vrai service, modeste et peut-être peu reconnu, faiblement efficace à vues humaines, mais à coup sûr fécond.
Le signe de la fraternité veut faire savoir que si Dieu s’adresse à chaque homme au plus fort de sa liberté, c’est pour que chaque homme puisse être intégré dans la communion des hommes, puisse être accueilli et demeurer dans le monde qui est donné aux hommes. Notre mission ? A cause du Fils, ami des hommes, devenir à notre tour amis des hommes pour que les hommes puissent vraiment habiter ce monde, et entendre que c’est bien à eux que Dieu s’adresse, Lui qui veut faire alliance avec l’humanité en demeurant dans ce monde. C’est le fondement et l’horizon de notre espérance.

Bruno Cadoré op,
le 15 février 2016